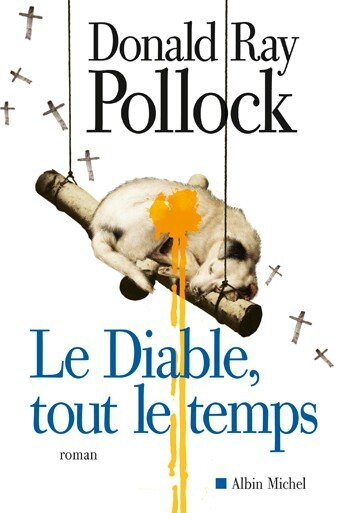 Le Diable, tout le temps (The Devil All The Time), roman de Donald Ray Pollock
Le Diable, tout le temps (The Devil All The Time), roman de Donald Ray Pollock
Éditions Albin Michel, 2012
Traduction Christophe Mercier
«Par moi on va dans l’éternelle douleur, Par moi on va parmi la gent perdue…Vous qui entrez laissez toute espérance ». Si Dante situe sa Cité des Peines aux portes du Premier Cercle de l’Enfer, Donald Ray Pollock désigne Knockemstiff, commune rurale de l’Ohio, trou du cul du monde et trône désigné d’un Diable souverain. Force est de constater qu’il existe pour l’auteur, des lieux où le Ciel semble ne plus répondre, trop occupé ailleurs ou lassé des mensonges des Hommes. Á moins que le Diable eût raison de jouer Job perdant et que Dieu dépité s’en soit retourné à ses affaires depuis des lustres. Seule certitude, le mal s’est installé dans l’Ohio comme une gangrène sournoise, grignotant les confins du Midwest, jusqu’en Virginie-Occidentale.
Publié après un recueil de nouvelles, ce premier roman de Pollock est un coup de maître, un trente tonnes dans le buffet, un uppercut qui laisse knock-out, salué en chœur par une critique et des lecteurs qui ont bien du mal à se remettre ensuite d’aplomb. On ressort assez crasseux de cette plongée dans la fange, mal à l’aise ou carrément effrayé, comme si on nous avait passé en boucle Délivrance. Pas de duel au banjo saccadé, le thème du livre raisonnerait plutôt d’un cantique très dévoyé. Car le diable a planté sa fourche dans un bled perdu, où la seule dévotion fanatique tient lieu de code civil : le puritanisme extrême, la bigoterie, l’ascétisme dévié ont enfanté la bêtise, la cruauté, la corruption, des prédateurs sexuels, des meurtriers vicieux, un défilé hideux de pervers, toute une pleine communauté nocive et délétère qui macère dans sa boue. Qu'elle est obscène cette Amérique profonde ! Pollock suit durant deux décennies (de la fin de la guerre au milieu des années soixante) une poignée de personnages aux destins mêlés, qui courent tous à leur perte, comme des créatures dégénérées et impuissantes, se jetant immanquablement d’une falaise. Et l’inventaire est franchement vomitif : deux prédicateurs cousins, Roy et Théodore, le premier meurtrier, le second pédophile, l’avocat voyeur et pourri Henry Dunlap, Lee Bodecker, le shérif aux mains souillées de sang, Sandy et Carl, couple d’exterminateurs qui torturent et massacrent de jeunes auto-stoppeurs lors de leurs virées sur les routes, Preston Teagarden, pasteur contrefait qui dépucèle à la chaîne les très jeunes filles de sa paroisse et William Russel, rescapé traumatisé de la guerre du Pacifique, qui cloue des carcasses d’animaux morts sur des croix en aspergeant de leur sang un autel de prière, avant de tâter du sacrifice humain. 370 pages de cauchemars.
D’autant que ce joli catalogue de dénaturés n’a pas forcément conscience de basculer de l’autre côté : ils ont l’intime conviction d’avoir une ligne directe avec Dieu et d’agir en son nom. Théodore boit de la strychnine pour éprouver sa foi, Roy trucide sa femme parce que Dieu lui a confié le pouvoir de la ressusciter, Carl ne sent la présence divine qu’en donnant la mort, Preston Teagarden verse dans la corruption de mineurs pour se repentir de quelque chose le moment venu, et aller ainsi au Paradis… on peut être le pire salaud et avoir sa part d’humanité. Après tout, ils ne sont pas les premiers, ni les derniers, à tuer au nom de Dieu…
Pas de Justes dans cette pestilence ? Si, mais ils se pendent, ou finissent dézingués au tournevis.
Qu’est-ce qui empêche alors le lecteur de repousser cette noirceur extrême et désespérée, de refermer ce livre nauséabond ? En premier lieu, une authentique écriture, posée, tenue, bridée, qui ne verse jamais dans la fascination du crime et dans des descriptions hypnotiques des atrocités commises. Bien souvent, la plume de Pollock s’arrête avant et reprend ensuite. C’est le lecteur qui imagine, qui construit, qui visualise ce que le romancier refuse de mettre en mots. Pollock nous met alors en porte-à-faux en nous renvoyant à notre propre inclination pour la monstruosité et le vice. Très inconfortable.
Il faut dire aussi que l’auteur, issu de ce même creuset, de cette même terre, attache ses personnages à leur milieu d’origine : Roy, Théodore, Sandy et les autres ne sont pas l’incarnation du mal par principe ou par goût, ils sont issus d’une histoire, d’un lieu, d’une certaine american-way-of-life subie. Tous les habitants de ces localités reculées sont plus ou moins parents, rejetons abâtardis, souvent arriérés, bref prédéterminés aux comportements déviants. Ils naissent perdus d'avance, dans des foyers pauvres et frustres, où règnent violence, alcoolisme, misère, et arrêtent l’école à seize ans pour ramener quelques dollars à la maison. Les gars travaillent à l’abattoir de porcs ou à l’usine de papier qui sent l’œuf pourri, les filles se font culbuter trop tôt, se cognent au mépris, à la vulgarité, à la sauvagerie des hommes. Un monde sans lumière, sans espoir, sans bonté, sans amour, sans culture, contraint les personnages à la survie, à n’importe quel prix, si infâme soit-il. Et c’est pourquoi Pollock ne juge jamais ses personnages et n’assène aucun discours moralisateur. Pas besoin d’attendre le trépas pour goûter des atrocités à l’odeur de soufre, l’enfer est ici-bas, sans rédemption possible.
 Ces quelques instants de grâce arrivent quatre ou cinq fois par an, guère plus : à pratiquer une ville à outrance, on finit par ne plus rien voir, ne plus rien ressentir, stigmatisant sans relâche les défauts inhérents à toutes les capitales européennes : on a pour Berlin, Londres ou Rome les yeux de Chimène, mais on étrille furieusement Paris, parce qu’on y vit (mal) au quotidien, qu’on y travaille (trop) et que ces disgrâces finissent par l’emporter sur ses charmes. Surtout parce que l’on oublie bien souvent de lever le regard, de prendre son temps, de la contempler tel un visiteur qui la rencontrerait pour la première fois.
Ces quelques instants de grâce arrivent quatre ou cinq fois par an, guère plus : à pratiquer une ville à outrance, on finit par ne plus rien voir, ne plus rien ressentir, stigmatisant sans relâche les défauts inhérents à toutes les capitales européennes : on a pour Berlin, Londres ou Rome les yeux de Chimène, mais on étrille furieusement Paris, parce qu’on y vit (mal) au quotidien, qu’on y travaille (trop) et que ces disgrâces finissent par l’emporter sur ses charmes. Surtout parce que l’on oublie bien souvent de lever le regard, de prendre son temps, de la contempler tel un visiteur qui la rencontrerait pour la première fois.







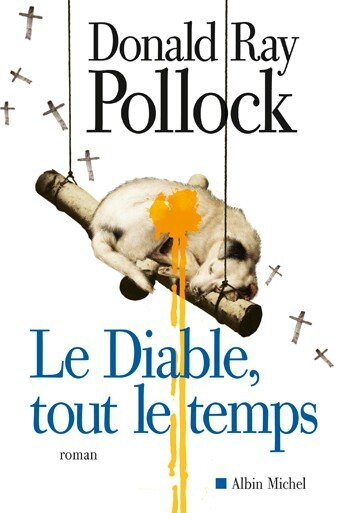

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)