La Trilogie « Gormenghast », romans de Mervyn Peake
Titus d’Enfer (Titus Groan, 1946) / Gormenghast (Gormenghast, 1950) / Titus Errant, (Titus Alone, 1959)
Éblouissante traduction de Patrick Reumaux, chapeau bas...
La postérité peut être sacrément injuste dans le tri qu’elle fait des écrivains. Si elle est incapable de les ranger dans le bon tiroir, si ça dépasse, si ça coince, si ça se singularise à outrance, vlan, aux oubliettes de l’histoire littéraire, perte sans profit, voilà ce qui arrive aux singuliers qu’on ne peut mettre au pluriel. Dessinateur, illustrateur des Contes de Grimm, d’Alice au pays des Merveilles, de L’île au trésor, poète, dramaturge et romancier, Mervyn Peake (1911 - 1968), fait figure d’artiste bizarre à peine identifié, même dans son Albion natale. Si l’on sait ce que sa trilogie n’est pas, bien malin celui qui pourrait la définir en deux lignes : trop tardive pour être rattachée au Roman gothique, dont il n’a gardé que le goût pour les châteaux et les ruines, pas assez insolite pour lorgner vers l’Heroic Fantasy, trop réaliste pour s’arrimer au fantastique, trop sombre pour un conte, trop atypique pour devenir une légende... on la présentera comme un long récit imaginaire de 1512 pages et puis c’est tout, je ne me risquerai pas au-delà.
Le lecteur se cramponne comme il le peut à son seul point d’ancrage, le gigantesque, le dantesque château de Gormenghast, berceau héréditaire des Comtes d’Enfer : forteresse inextricable, dédale de pierres extravagant, masse grise démesurée hérissée de tours hirsutes, fantaisie architecturale, construction oppressante et lourde qui incarne les rêves excentriques des 76 Comtes qui se sont succédés dans ces murs, la superbe du château règne sur le roman, loin devant le destin des personnages, les intrigues, les rebondissements. Avant tout dessinateur, Mervyn Peake possède le don merveilleux d’une prose visuelle qui donne vie à son décor : les longues descriptions des différentes ailes du château ne sont jamais rébarbatives ou superfétatoires. Il peut se permettre de nous prendre par la main pour une balade de dix-huit pages sur les toits du château, sans que notre attention faiblisse. Il faut bien avouer que la structure de Gormenghast recèle d’inventions très graphiques, comme ces arbres jaillissant à angle droit de la maçonnerie, suffisamment énormes pour que des personnages s’y promènent comme sur un boulevard et y prennent le thé, ou ces tours circulaires, transformées en bassin par l’eau des pluies, servant de piscine naturelle pour les juments et leurs poulains… Dessinateur mais aussi poète, donc narrateur délicat, adepte de la nuance, de la demi-teinte, de la phrase qui se déroule lentement avec grâce : « accrochant à son col une broche de pierres précieuses, il soupira, et au sein de l’océan tragique de ce soupir se fit entendre le murmure d’une vague moins amère ».
Ce fief austère, trop vaste, humide, vétuste, voire déliquescent, pourri par des pluies diluviennes, est un monde clos, figé, silencieux, vide, d’une incommensurable tristesse. La famille d’Enfer, ses serviteurs, son médecin, forment une galerie de portraits curieux, très imagés. Si au commencement était le verbe, Mervyn Peake donne à ses personnages des noms très évocateurs, pour les croquer d’un simple trait : Craclosse, Lenflure, Finelame, Tombal, Salprune, Grisamer, Brigantin, ces noms caractérisent immédiatement la nature de l’individu. Ils sont saisis sur le vif, par un détail de leur anatomie, un tic de langage, une attitude, une gestuelle, qui résume leur caractère ou leur destin : « Le Dr Salprune sourit, exhibant deux éblouissantes rangées de dents plantées dans ses gencives comme des pierres tombales… le rire du Dr Salprune faisait partie de sa conversation… ce rire évoquait le vent sifflant dans les combles, ou le hennissement du cheval. Ce n’était d’ailleurs pas un rire humoristique, mais un simple accident de conversation… ». Le chef des cuisines, l’énorme Lenflure, entre en scène et harangue ses jeunes marmitons avec un laïus à la saveur toute personnelle : « Venez mes calculs ! Venez mes biliaires ! Écoutez-moi avec attenchion ! Mes chérubins tranchpirants, dites-moi qui je chuis ? Lenflure ! C’est tout ce que chavez mon petit ochéan de trognes ? Chilenche ! Chef de Gormenghast, homme et garchon, chage et fou, choleil et pluie, chable et chiure, cornes et cul, tout cha pluche une pinchée de poivre rouge ! ». Mervyn Peake excelle dans ces représentations réalistes, animées, saisissantes, éminemment drôles, de ses personnages. Avec toujours le détail qui fait mouche : « Irma était étendue de tout son long sur le sol. Elle se contorsionnait comme une anguille qu’on vient de couper en deux et qui garde encore quelques idées personnelles sur les contorsions ».
La trilogie relate l’enfance, l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte de l’héritier de Gormenghast, Titus d’Enfer, au moment où un jeune apprenti des cuisines, Finelame, décide de s’élever dans l’échelle sociale du château, au prix de manigances, de trahisons et de meurtres. Ces deux personnages vont, chacun à leur manière, dynamiter l’ordonnancement du château, ses rites ancestraux, son protocole, sa tradition étouffante qui régissent la vie de ses habitants. Plus que le Comte Tombal d’Enfer, c’est Grisamer, Maître du Rituel, Gardien des documents, qui règne en ces lieux et qui régit, avec l’aide de vieux volumes poussiéreux, l’emploi du temps de la famille : « dans le premier des trois tomes, la date était suivie par la liste précise de tout ce que le comte devait faire minute par minute pendant la journée. Les heures exactes, les vêtements à porter en chaque occasion, les gestes symboliques à accomplir ». Aucun affectif pour les membres de la famille, la Loi de Gormenghast, l’obéissance à la tradition, priment sur les individus : « Aucun membre de la famille en chair et en os n’éveillait en lui la loyauté qu’il éprouvait pour le symbole. Que le grand fleuve sombre de lignée poursuivît indéfiniment son cours, sans jamais sortir du lit de la terre sacrée, était son unique souci ». Nos deux insoumis verront sur les deux premiers volumes leurs destinées se croiser, se combattre, s’opposer dans la conception même de leur mutinerie : Titus d’Enfer cherche à se réaliser hors du château, quand Finelame sème le chaos pour se rendre maître des lieux. Ce combat à l’issue fatale contamine jusqu’au cœur même des pierres, qui suintent devant l’ennemi : « le mal est dans le château… quelque chose a changé… il y a quelqu’un, un ennemi… ce n’est pas un fantôme, la rébellion ne démange pas les fantômes… la malfaisance rode. » Combattant Finelame durant une tempête apocalyptique qui noie le château sous d’incessantes trombes d’eau, Titus sauvera Gormenghast du sinistre arriviste, comme une fin du parcours initiatique, où il laisse, en même temps que les dépouilles des siens, une partie de son innocence. Titus quittera alors sa terre natale pour éprouver cette liberté nouvelle, hanté par la pensée de cet autre monde qui pouvait exister hors de Gormenghast.
Ce dernier opus, qui relate les errances de Titus d’Enfer très loin de chez lui, souffre de l’absence de la forteresse, source première de fascination chez le lecteur. Le monde imaginé par Mervyn Peake ne ressemble à rien de connu, tout en étant vaguement familier, comme une excroissance de pierre sortie de terre, un magma originel aux limites floues, autour duquel tournerait tout l’univers. « Il n’y a pas d’ailleurs. Tu ne feras que parcourir un cercle, Titus d’Enfer. Il n’y a pas de route, pas un sentier qui ne te ramène à ta demeure. Car tout mène à Gormenghast ».

















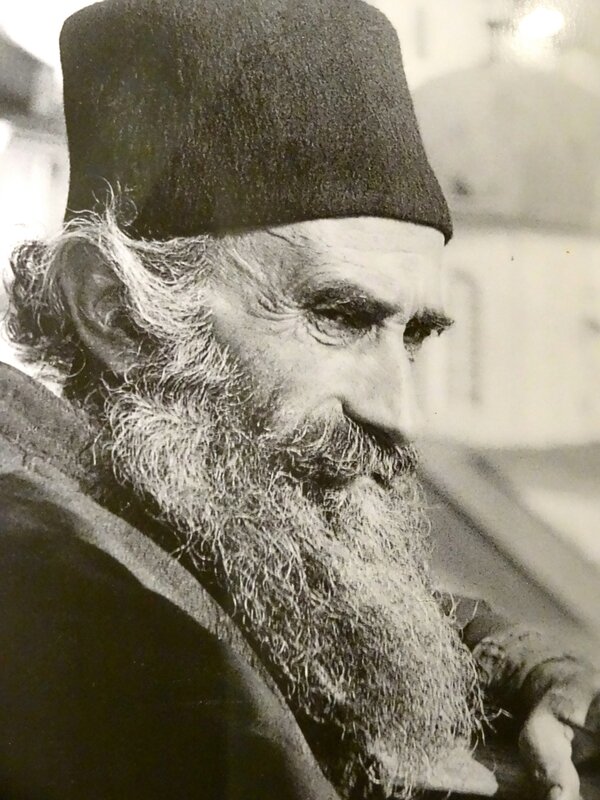










/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)