 La Conjuration des imbéciles, roman de John Kennedy Toole
La Conjuration des imbéciles, roman de John Kennedy Toole
Traduction de Jean-Pierre Carasso
Éditions 10/18 - Prix Pulitzer 1981
Si l’on ricoche parfois de livres en livres dans une totale pagaille, il arrive qu’un invraisemblable roman vous donne envie d’en savoir plus sur sa généalogie : en partant à l’aventure sur les sources des personnages désopilants et farfelus de Gary Shteyngart, un nom, de ma pomme inconnu, est revenu sans cesse sous la plume des critiques américains : Shteyngart devrait beaucoup à un certain John Kennedy Toole… Toole, mouai, mais encore ? Pas la peine de se triturer le cervelet, je suis passée totalement à côté du chemin, le gars sonne pour moi aux abonnés absents. Et manque de bol, on lui voue un culte outre-Atlantique, le mythe tenant autant à la singularité du texte qu’au destin dramatique de son auteur.
Né en 1937 à la Nouvelle-Orléans, John Kennedy Toole ne connaît de son vivant que des échecs et les rebuffades des éditeurs. Convaincu d’être un piètre écrivain, il se suicide par asphyxie à l’âge de 32 ans, laissant deux manuscrits dans le tiroir. Sa mère forcera les portes durant une décennie pour faire publier La Conjuration des imbéciles, qui obtiendra le Putlizer, à titre posthume. Par une funeste ironie, Toole choisit comme personnage principal un homme de plume solitaire, un peu réactionnaire, incompris de ses contemporains, qui noircit des monceaux de cahiers, dans sa Louisiane natale, affublé d’une mère un brin étouffante. Le roman n’a cependant rien d’une tragédie lugubre, c’est même tout le contraire. Toole choisit l’éclat de rire, le burlesque, le loufoque, le franchement ridicule, pour épingler son époque et la société du Sud.
Notre héros, Ignatius Reilly, cuistre oisif hypocondriaque et misanthrope, la trentaine froissée, vit toujours au crochet de sa môman, retranché dans la tanière qui lui sert de chambre ; « décidé à ne fréquenter que mes égaux, je ne fréquente bien évidemment personne puisque je suis sans égal. » L’ego du bougre est aussi phénoménal que son tour de taille, aussi délirant que son accoutrement, aussi monumental que son érudition. Il y a chez lui un je-ne-sais-quoi qui le rapprocherait d’un Achille Talon irradié, mâtiné d’un Ubu, démesuré, boursoufflé, et qui aurait jeté sa bonne éducation par-dessus les champs de coton. Lorsqu’on lui demande à quelle tâche il occupe ses journées, vêtu de sa chemise de nuit crasseuse de flanelle rouge, il répond nonchalamment : « je suis à l’œuvre sur la rédaction d’un long acte d’accusation contre notre société. » Car Ignatius est un anachronisme vivant, un médiéviste fixé sur la seule rota Fortunae, la roue du destin, concept fondamental du De consolatione philisophiae, de Boèce**. Inutile de parler de démocratie à un homme qui considère que la musique est entrée en décadence après Scarlatti. « Les États-Unis ont besoin d’un peu de théologie et de géométrie, d’un peu de goût et de décence. Je crains que nous ne soyons en train de tituber au bord du gouffre…. Ce que j’appelle de mes vœux, c’est une bonne monarchie solide. »
Mais, lorsque Madame Reilly mère, un peu portée sur la boisson, provoque une catastrophe au volant de sa vieille Plymouth, la rota Fortunae enclenche un mauvais cycle pour notre érudit : il lui faut rejoindre les rangs des travailleurs pour éviter l’hypothèque de son sanctuaire. « Les employeurs perçoivent en moi la négation de leurs valeurs…ile se rendent compte que je vis dans un siècle que j’exècre… mais le fait d’agir au sein même du système que je critique représentera en soi un paradoxe ironique non dépourvu d’intérêt ». La rencontre de notre inadapté caractériel avec le monde réel fournit d’invraisemblables aventures, des rencontres détonantes, un vrai choc de civilisations, où le plus fou n’est pas forcément celui qu’on croit.
Car les insérés du grand rêve américain sont tout autant gratinés, sans recul sur la vie sous-vide que la société de consommation leur impose, nivelés par le bas, satisfaits de leur mesquinerie et de leurs compromissions. Comme le grand coup de pied d’Ignatius dans ce nid de cafards soulage, libère, fascine ! Le cinéma hollywoodien (cochonnerie turpide), la télévision (totale perversion), les psychiatres (ils essayeraient de faire de moi un crétin, amateur de télévision, de voitures neuves et d’aliments surgelés…tous les asiles sont pleins de gens qui ne supportent pas la lanoline, le cellophane, le plastique, c’est leur seul crime, c’est pour cela qu’on les enferme !), la religion (mon opposition au relativisme du catholicisme moderne est assez violente), l’université (trop mesquine pour accepter un acte de défi contre la stupidité abyssale de l’académisme contemporain… analphabétisme… bourbier intellectuel), les étudiants (par égard pour l’humanité future, j’espère qu’ils seront tous stériles), tout passe dans la grande machine du « re-cervelage », dans un rire vorace !
Ignatius porte cependant un tendre regard sur son ancienne copine de faculté, Myrna Minkoff, dite « la péronnelle » avec laquelle il entretient une liaison épistolaire suivie : admiratrice de Freud, activiste, braillarde, pasionaria caricaturale des combats des sixties, en première ligne dans chaque manifestation ou défilé, la demoiselle qui voit dans une sexualité débridée le seul remède aux maux de son époque, est le contrepoids énergique de ce puceau d’Ignatius, adepte de la seule veuve poignet et tourmenté par ses soucis gastriques et la fermeture intempestive de son anneau pylorique. Quand Ignatius quitte ses méditations pour entrer dans l'univers des gueux sous-payés, il n’aura de cesse de défier Myrna sur son propre terrain, en déclenchant d’épouvantables cataclysmes : insurrection d’usines, Croisade pour la dignité des Maures, création du Parti de la Monarchie de droit divin, puis d’un Parti de la Paix, uniquement composé de « sodomites », vaste complot à l’échelle mondiale pour que tous les militaires du monde soient gays et préfèrent l’amour à la guerre.
Le delirium de Toole ne connaît aucune limite et on se pâme de joie devant ses trouvailles de langage, ce bas-parler des bouges de la Nouvelle-Orléans, les subjonctifs imparfait d’Ignatius et sa rhétorique au cordeau se fracassant sur la syntaxe malmenée des entraîneuses, des vieilles toupies, des vendeurs de hot dogs (tâtez de mes saucisses, 20 cm de paradis), des flics et des folles furieuses (c’est une abomination à faire avorter une vache aveugle !).
La satire, la farce, l’hénaurme sont au menu de cette exaltante Conjuration, très politiquement incorrecte. Comme le souligne Swift, "quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui".
* Beaumarchais, in Le mariage de Figaro
** Philosophe né en 470, oui, ce n’est pas d’hier !












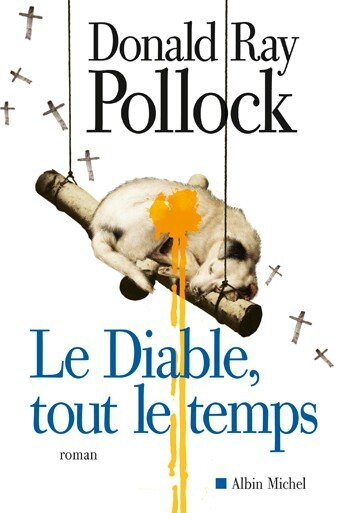

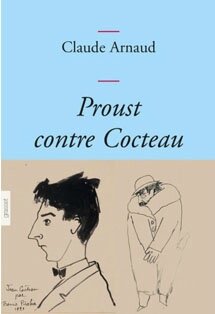



 La Conjuration des imbéciles, roman de John Kennedy Toole
La Conjuration des imbéciles, roman de John Kennedy Toole Absurdistan, roman de Gary Shteyngart
Absurdistan, roman de Gary Shteyngart La Tristesse du Samouraï, roman de Victor Del Arbol, Prix du Polar Européen 2012
La Tristesse du Samouraï, roman de Victor Del Arbol, Prix du Polar Européen 2012
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)