Destins crépusculaires (The Fall of Light), roman de Niall Williams
 Editions Denoël, 2003
Editions Denoël, 2003
Il y a des jours où l’on se dit qu’on a bien fait de pousser la porte de son libraire : usant et abusant des emplettes en ligne, on oublie bien souvent qu’être libraire est un métier, et que des décennies passées le nez dans les livres aiguisent forcément l’esprit et la curiosité. Alors que j’errais entre les tables des « nouveautés », qui ploient sous l’originalité la plus hardie (« ma culture et moi », « mon ego et moi », « mes traumas et moi », « ma famille et moi »), je demandais de l’aide à la recherche d’un vrai roman, avec une écriture, une histoire, des aventures, des personnages, à l’opposé des introspections nombrilistes et douteuses. Destins crépusculaires fut mis d’office dans mes mains, avec un « Ne vous fiez pas au titre traduit façon best-seller aguicheur, Niall Williams est un très grand écrivain irlandais. »
Né à Dublin, expatrié durant quelques années à New York, puis revenu sur son île en 1985 où il commence une carrière d’écrivain et de dramaturge, Niall Williams peint une fresque familiale sur fond de famine et d’exode ; la destinée du clan Foley. Issu d’une lignée de rebelles hostiles aux gros propriétaires terriens qui ne quittent jamais l’Angleterre, mais qui maintiennent les paysans irlandais dans une extrême pauvreté, le patriarche Francis Foley décrète un jour qu’il ne peut plus laisser croupir sa famille dans l’injustice, l’indigence et le mépris, met le feu à la demeure de l’invisible châtelain et fuit le comté de Tipperary pour celui de Clare, avec ses quatre fils. Le clan sera rapidement dispersé et chacun suivra sa route sur trois continents, se cherchant les uns les autres, se croisant, se perdant.
Rien de déprimant dans le roman, pas d’inclination pour le misérabilisme, d’aucuns pourraient presque reprocher un manque de réalisme. L’auteur préfère à l’énergie narrative le déroulement très lent d’une histoire familiale « merveilleuse » où les coïncidences et la fatalité jouent tout leur rôle. Les pages qui relatent le fléau de la famine, les expulsions de familles entières sous les yeux d’huissiers infâmes, les suicides, les crises de folie, les hommes réduits à manger de l’herbe et les cadavres qui pourrissent à l’air libre, tout comme les conditions inhumaines de la traversée vers New-York pour les émigrants, dans les cales de navires-cercueils, sont assez brèves. Niall Williams fait de l’épopée familiale un récit légendaire, fondateur d’une lignée : il délaisse la brutalité historique et pare le roman d’un éclairage de conte, où les morts et les vivants se répondent par symbole, où les animaux ont une part de féérie, où ceux qui ont tout perdu se raccroche aux constellations dont ils se racontent les légendes. La prose devient souvent lyrique, les phrases s’enroulent, sinuent pour décrire les paysages irlandais, ses ciels changeants et sa nature sauvage, ces liens indissolubles que cette terre tisse avec tous ceux qu’elle a portés. Pas d’images convenues, ou de descriptions ordinaires mais une perception onirique des éléments et de leur influence sur les hommes. D’ailleurs, aucun des quatre fils Foley n’est dépositaire du combat social du père : tous semblent flotter, les yeux rivés sur leurs étoiles, qui leur fait suivre un long chemin, traverser de grands espaces vierges, tels des juifs errants à la recherche d’eux-mêmes.




 Onze histoires de solitude (Eleven Kinds of Loneliness)
Onze histoires de solitude (Eleven Kinds of Loneliness) Editions Actes Sud, 2011, Prix Jean Giono 2011
Editions Actes Sud, 2011, Prix Jean Giono 2011 Editions P.O.L 2011, Prix Renaudot 2011
Editions P.O.L 2011, Prix Renaudot 2011 Livre 2 Juillet-Septembre, Editions Belfond
Livre 2 Juillet-Septembre, Editions Belfond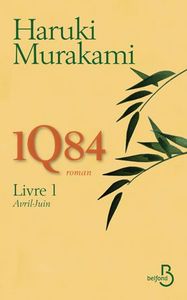 Livre 1 Avril-Juin, Editions Belfond, 2011
Livre 1 Avril-Juin, Editions Belfond, 2011 Éditions Robert Laffont, 2011
Éditions Robert Laffont, 2011
 Editions Actes Sud, 2010
Editions Actes Sud, 2010 Je me méfie toujours un peu quand un livre fait autour de lui l’unanimité, quand tout le « prêt-à-critiquer » parisien hurle au chef-d’œuvre d’une seule voix extatique. Au risque de passer pour une pisse-vinaigre, on va laisser tomber la pensée unique et se faire une idée personnelle.
Je me méfie toujours un peu quand un livre fait autour de lui l’unanimité, quand tout le « prêt-à-critiquer » parisien hurle au chef-d’œuvre d’une seule voix extatique. Au risque de passer pour une pisse-vinaigre, on va laisser tomber la pensée unique et se faire une idée personnelle. Editions Denoël, 2010
Editions Denoël, 2010/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)