Qu'est-ce qu'on se fait suer...
 Les îles grecques - Lawrence Durrell - 1978 - Rééd. Bartillat, 2010
Les îles grecques - Lawrence Durrell - 1978 - Rééd. Bartillat, 2010
Il faut dire aussi que les francophones ont de la chance : Jacqueline de Romilly, Jean-Pierre Vernant et Jacques Lacarrière forment, vue de ma fenêtre, la Sainte Trinité de l’hellénisme éclairé, dans lesquelles on va piocher selon son humeur. Des récits, des réflexions, des études, des voyages, quelquefois un peu escarpés, d’autres plus accessibles mais toujours animés d’un enthousiasme prodigieusement communicatif.
On se dit alors qu’ils n’y a pas de raison que nos voisins grands-bretons ne partagent pas notre emballement bouillonnant, surtout lorsqu’un écrivain anglais, né en Inde, passé par Alexandrie, a parcouru autant de miles dans le bassin méditerranéen, pour nous offrir 339 pages de réflexions sur son histoire avec la Grèce. Un détail m’avait pourtant interloquée en feuilletant l’ouvrage : entre 1935 et 1956, Durrell choisit de se fixer à Corfou, Rhodes puis à Chypre, en somme sur la périphérie du monde hellénique actuel. Un choix un tantinet « timoré », comme si le monsieur était un poil chichiteux, limite sophistiqué coincé, ce qui n’augurait rien de bon pour ses relations avec le peuple grec contemporain.
Morceaux choisis :
« La vie dans les petits villages… c’est le règne de l’étroitesse d’esprit, de l’ignorance, des bas coefficients d’intelligence, qui signifient la mort de l’art. C’est une vie horrible non seulement à cause des privations matérielles mais de l’asphyxie intellectuelle. » Sic.
« Les pays pauvres n’ont pas les moyens de produire de grands cordons-bleus, et sans doute risque-t-on de manger abominablement mal en bien des endroits en Grèce…une fois passées les premières déceptions, on se résigne rapidement à accepter avec impassibilité la pitance qui se présente – de toute façon, il se présente aussi des choses excellentes, comme les homards ou les langoustes à Hydra ». Re-Sic.
On hésite entre tomber de sa chaise ou se dilater sauvagement la rate, ça dépend de l’humeur du jour. Ce voyageur poseur, fat, bêcheur exprime bien souvent du mépris pour les habitants, comme un colon pour les indigènes. Certes, il chérit la Grèce ou du moins, une certaine idée de la Grèce, son histoire prodigieuse, ses mythes et ses légendes, sa grandeur passée, ses paysages et sa lumière. Il est vrai que ses digressions sur l’archéologie, l’architecture, la littérature et la poésie, sont pertinentes et fines, la beauté de son écriture est manifeste, sa solide culture classique lui permet de belles pages sur la Crête et Rhodes. Mais Durrell n’a pas la générosité, la chaleur, la flamme d’un Lacarrière, pétri d’empathie pour les Grecs. Il trouve plus piquant de distiller sa morgue et ses opinions lapidaires avec un aplomb renversant :
« … escale inintéressante dans l’île d’Ikaria : elle a l’air rude et mal tenue, comme si elle n’avait jamais été aimée de ses habitants. La première impression de désordre et d’incertaine utilité se trouve renforcée par le réseau routier qui semble avoir été conçu par un facteur saoul. Il serait parfaitement vain d’essayer d’en dire plus long sur cette île ».
Si Durrell touche le fond, il creuse encore avec Amorgos, où il expose sa bêtise crasse :
« île plutôt sinistre qui n’a pas grand' chose à son crédit…si par hasard vous vous laissiez coincer là, vous y péririez d’ennui comme un géranium qu’on a oublié d’arroser. »
Tenant Amorgos pour la plus belle des Cyclades, je ne peux que vous engager à vous tenir très loin de la mesquinerie de Durrell et à vous replonger, encore et toujours, dans L’Été grec.




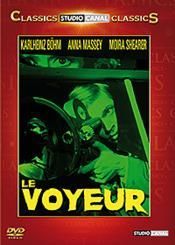

 Oh, la claque ! Je suis à la fois atterrée d’être passée loin de ce film durant tant d’années et béate de joie qu’il ait enfin croisé mon chemin… mais aussi vermillon cramoisi devant mes lacunes cinématographiques. Á la décharge du public européen, ce film anglais fut un échec lors de sa sortie, boycotté par ses producteurs et le distributeur, tombé aux oubliettes, mais devenu culte outre-Atlantique. « Indéniablement le plus beau film en Technicolor. Une vision jamais égalée » pour Martin Scorcese, « The Reds Shoes est le seul film à voir avant de mourir », pour Francis Ford Coppola.
Oh, la claque ! Je suis à la fois atterrée d’être passée loin de ce film durant tant d’années et béate de joie qu’il ait enfin croisé mon chemin… mais aussi vermillon cramoisi devant mes lacunes cinématographiques. Á la décharge du public européen, ce film anglais fut un échec lors de sa sortie, boycotté par ses producteurs et le distributeur, tombé aux oubliettes, mais devenu culte outre-Atlantique. « Indéniablement le plus beau film en Technicolor. Une vision jamais égalée » pour Martin Scorcese, « The Reds Shoes est le seul film à voir avant de mourir », pour Francis Ford Coppola.
 Homère, Iliade - relecture d’Alessandro Baricco – Éditions Albin Michel, 2006
Homère, Iliade - relecture d’Alessandro Baricco – Éditions Albin Michel, 2006/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)