Rebelote, les bons auspices, les jours alcyoniens (rappel de la légende, ici) furent de nouveau de la partie, comme il y a deux ans, en Grèce en ce début janvier. Tout le monde nous prédisait du froid, de la pluie et du vent dans le Magne ; que nenni, la parenthèse de beau temps, inespérée en janvier, s'est ouverte le 08, pour se clore le samedi 16, il est vrai. Et Athènes, par trois petits degrés, éteinte sous un ciel cendreux, parcourue de violentes rafales de vent, c'est tout de suite beaucoup moins agréable.
Petite info pour les lecteurs gays qui passeraient par ici ; si vous cherchez LA librairie gay d'Athènes, il faut aller au 6 Antoniadou, station de métro ligne verte Victoria, chez Polychromos Planitis. Nous sommes allés chercher en ce lieu un exemplaire du scénario de Strella, film de Pános Koútras dont nous sommes de grands fans (Koútras et Yorgos Lánthimos sont d'incroyables réalisateurs du cinéma grec actuel / si vous tombez sur le Canine de Lánthimos, n'hésitez pas mais accrochez-vous !). Il ne s'agit en fait pas d'une boutique mais d'un appartement planqué, transformé en librairie, à la sonnette très discrète. Je ne croyais pas les grecs aussi culs-serrés... y'a encore du chemin à faire au pays de Sapho et de Cavafy.
D'ailleurs, comment va-t-elle Athènes, lorsqu'elle n'est plus sous les feux de l'actualité ? Pas très bien. Elle a beau garder ses décorations de Noël encore allumées pour donner un air de fêtes et de légèreté à ses rues, peine perdue, ça craque de partout.


Toujours plus de sans abris, de rideaux baissés, d'immeubles désertés aux fenêtres définitivement closes ; passé la place Iroon, Psiri est devenue une zone fantôme, silencieuse, qui a déclaré forfait. Le quartier d'Omonia n'était déjà pas bien folichon, mais la capitulation est désormais bien palpable. Grève des bus le week-end de notre retour, manifestation d'agriculteurs et routes bloquées hier vendredi, le train de réformes délirantes et contreproductives imposées par les technocrates de Bruxelles entraîne encore la colère des Grecs mais quelque chose s'est éteint et cela se ressent. La gestion des migrants, abandonnée aux mains des Grecs sans qu'aucune aide ne leur soit apportée (sinon une bordée de reproches de ne pas savoir garder les frontières de l'Europe - sic !), laisse une lourde empreinte sur la ville ; d'Omonia à Victoria, donc dans le centre ville d'Athènes, les réfugiés s'entassent. Si la Macédoine décide de fermer sa frontière, la Grèce va-t-elle se transformer en un gigantesque camp de réfugiés sans moyens ? C'est la double peine pour Athènes, qu'on a saignée à blanc avant de lui refiler un problème sans solution. Si cet afflux continu commence à tailler des croupières à la seule ressource qui reste à la Grèce, le tourisme, c'est le chaos qui guette le pays. À se demander si tout cela n'est pas fait intentionnellement...
Je remonte, pour un peu de légèreté, le post vieux de deux ans sur les restos grecs, mis à jour. Car le fait de revenir sans cesse à Athènes permet d'être plus curieux gustativement et de laisser les incontournables Palia Taverna tou Psara et autres Scholarchio Ouzeri Kouklis pour de nouvelles rencontres.
To Kafenio, Epicharmou 1 Plaka
Tout à côté du Scholarchio, dans un quartier très touristique, table moyenne qui doit beaucoup à son emplacement calme et à sa jolie salle. Cuisine toute simple mais inégale (choisir les plats annoncés "maison" plutôt que les classiques beignets de courgettes ou croquettes de légumes, clairement industriels). Féta étonnamment caoutchouteuse. Préférez clairement le Scholarchio.
Evcharis, Adrianou 49 Monastiraki
Testé au déjeuner et au dîner. De l'ambiance, vu l'importante fréquentation. La salle du fond sous verrière est bien engageante avec sa jolie déco, musique le soir. Très bon agneau au four en papillote (arvaki), salades très fraîches. Beaucoup plus de Grecs que de touristes malgré l'adresse.
Dia Tafta, Adrianou 37 Monastiraki
Dans la même rue que le précédent, un peu plus loin lorsque l'on va vers la station Thissio. Malgré des chaises de paille inconfortables au possible, bon repas de taverne, sans surprise mais réconfortant. Assiettes généreuses, trois mezzés sont suffisants pour rassasier le soir deux estomacs.
Ciccus, Andrianou 31 Monastiraki
Ciccus est le lieu où nous prenons souvent un verre (pas sur sa terrasse très fréquentée mais à l'intérieur, sous sa verrière, pour la déco), ouzo pour J-P, Aperol Spritz pour moi. Coincés un soir de fin septembre par un temps exécrable, nous y avons dîné, faute de pouvoir mettre un pied dehors sans être immédiatement douchés. La carte est plus "moderne" que les tavernes habituelles et nous avons été assez étonnés de la qualité des plats, et surtout par la carte des vins (attention, l'addition peut très vite s'envoler). Un plan B (effectué de nouveau en janvier, par grosse flemme) qui s'est révélé plus que convenable.
To Steki tou Ilia, Eptahalkou 5 Thissio
Pas facile à trouver, cette psistaria ! Prendre à droite, dans le chemin sous les arbres, juste après la station de métro, ne surtout pas remonter Apostolou. Vous ferez un saut dans le temps et l'espace. L'établissement semble ne pas avoir bougé depuis des décennies, avec ses nappes à carreaux, ses murs couverts de lambris et ses tonneaux en hauteur. C'est Grec de chez Grec, ça parle haut, ça fume beaucoup et ça boit sec. Courte carte, les locaux viennent pour les païdakia de haute volée. J'en connais un qui s'en lèche encore les doigts... Deux merveilles trouvées dans la traduction très poétique des plats en français : Tirokafteri devient trempette dans le fromage épicé et les Païdakia, lait de brebis... le repas n'a pas commencé mais vous êtes déjà de bien belle humeur...
Nikitas, Agion Anargyron 19 Psiri
Ne cherchez plus To Zidoron, juste à côté, remplacé désormais par un café
Bonne cantine de déjeuner, blindée à partir de 14h30 par les employés du coin. Plats du jour à la craie sur l'ardoise murale, pas toujours faciles à déchiffrer. Le plus simple, aller en cuisine et choisir sur place. Service souriant. Bœuf mijoté à la tomate et aux petites pâtes (kokkinisto me kritharaki) goûteux.
To Krassopoulio tou Kokkora, Esopou 4 Psiri
Voilà le genre d'endroit comme on les aime, où on se sent bien sans savoir pourquoi, où l'on revient sans se poser de question. Un lieu vite familier, où l'on a l'impression de dîner depuis des lustres, comme en famille. Très belle déco de chineur bien chargée (transistors collector, vieilles horloges, gravures de mode, affiches d'époque - en tout cas pas de la nôtre -, photos des années cinquante, certaines un peu coquines mais il faut s'approcher de très près pour les voir), bref, plus une place sur les murs. Produits d'excellente qualité (tourte à la courgette succulente, poulet au yaourt et au miel fondant, plats aux saveurs de l'Asie Mineure, desserts maison) et vin chaud à la cannelle en pousse-café. Propriétaire avenant qui aime papoter avec les étrangers et éclairer la crise grecque de ses réflexions toutes personnelles. Gay friendly aussi.
Pour prendre un verre, avant ou après, The Party, plus haut en remontant Karaiskaki.
Oineas, Esopou 9 Psiri
Dans la même rue que le précédent. Resto fréquenté par les Grecs et par les touristes. Belle déco chinée à l'intérieur et carte très sympa, qui propose de bonnes salades (boulgour, lentilles, tomates séchées), de la féta au miel, des légumes grillés et des plats de viandes savoureux ; ça ne désemplit pas jusqu'à très tard et pourtant le service reste sympa et souriant (patronne un peu portée sur la boisson qui peut devenir collante...)
Psistaria Achilléas, Valtetsiou 62 Exarchia
Taverne de quartier, fréquentée par les habitués et ce jour-là par quelques prof's de fac. Service un peu bourru mais l'assiette de briam nettoyée en cinq minutes mettra le sourire aux lèvres du serveur. Bons mezze. Sans surprise mais couleurs locales assurées.
Diporto Agoras, à l'angle de Théatrou et de Sokratou Omonia
Taverne à l'ancienne, en sous-sol, non indiquée donc, ouvrez l'oeil, les deux trappes sont marrons. Pas de carte, le patron débite les 5 plats du jour (ou vous demandera de le suivre derrière les fourneaux et vous renverra à votre table avec un "κάτσε" bien claquant !) Deux plats de légumes, deux de viande, une salade et des sardines. Simple, copieux, pas cher, mais on descend surtout pour un joli voyage dans le temps. Salle tapissée de tonneaux, ambiance typiquement athénienne, bonnes ondes, atmosphère détendue. Vous aurez du mal à remonter à la surface ensuite !
Athinaïkon, Thémistokléous 2 Omonia
Vieille taverne fondée en 1932, où l'on croise touristes et locaux. Bon assortiment de mezze, plats copieux, bonnes ondes, on en redemande et on y retourne.
O Andreas, Themistokléous 18 Omonia
Toute petite ouzeri cachée dans une ruelle qui coupe Themistokléous sur sa gauche, lorsque l'on descend d'Exarchia vers Omonia. On y vient pour sa longue carte d'ouzo, ses produits de la mer très frais (sardines, poulpes, calmars...) et son atmosphère vraiment grecque (pas un seul touriste à chacun de nos passages). Une bonne taverne de quartier où il fait bon se poser aussi sous l'auvent, quand la pluie tombe à pleins baquets.
Klimataria, Platia Theatrou 2 Omonia
Taverne traditionnelle à laquelle on s'attache vite ; décor sympa, vigne qui dégringole et barriques de vin, musique à partir de 22h certains soirs, fréquentée bien davantage par les Athéniens que par les touristes. Les plats mijotés cuisent des heures sous des espèces de grosses cloches pour un fondant et une saveur délicate. Selon mon carnivore, leur agneau talonne de très près celui d'Amorgos, pour le moment jamais égalé. Pour les mangeurs de verdure, très bon ragoût de légumes aux herbes et au citron. Cuisine sans chichi mais qui ouvre l'estomac et vous met de bonne humeur. Service enjoué et souriant.

Karamanlidika, au croisement de Sokratous et d'Evripidou Omonia
Épicerie de quartier aux saveurs d'Asie mineure, où l'on déguste les produits phares, les fromages et la charcuterie. C'est brut, bien envoyé, on est à Omonia, que diable ! Comme les noms des produits étaient pour nous un peu nébuleux, on a laissé le garçon choisir à notre place ; assiette de fromages et de pastrami et deux sortes de saucisses de Cappadoce. Goûtez, picorez et on laisse loin derrière la moussaka et le tzatziki, pour d'autres saveurs, et des goûts plus épicés et marqués. Vraiment traditionnel, et super ambiance.

Paradosiako Oinomageirio, Voulis 44A Syndagma/Plaka
Á deux pas de la flopée d'hôtels des rues Apollonos et Mitropoléos, toute petite taverne familiale sympathique, grecque à l'heure du déjeuner, fréquentée par les touristes le soir. Plats simples de taverne, poissons du jour, pas chers et copieux. Mais un peu bruyant car situé en angle de deux rues très fréquentées.
O Tzitzikas kai o Mermygas, Mitropoleos 12-14 Syndagma
Changement d'ambiance avec un resto plus jeune dans sa déco design et ses plats plus originaux. Salade d'épinards bien troussée, mille feuilles de légumes entre deux fromages de mastelo, feuilles de vigne fines et parfumées, riches d'herbes et de feta, une cuisine moderne et légère. Tsipouro avant le dîner, liqueur de mastic à la sortie. Desserts au poil !
The Greco's Project, Nikis 9 Syndagma
Si votre ferry arrive au Pirée vers 15h30, que vous avez huit heures de traversée à jeun dans les jambes et que votre petit-déjeuner pris à 6h00 vous semble bien loin, où grignoter dans le quartier de Syndagma vers 17h, après vous être dessalés sous la douche à votre hôtel ? Trop tard pour un vrai déjeuner, bien trop tôt pour un dîner, pas envie de sucre à la pâtisserie du coin, nous avons donc tenté ce nouveau lieu à l'angle de Mitropoléos et de Nikis. Un peu branchouille, mais l'assiette, sans être transcendante, s'est révélée honnête et pas chère.
Sardelles, Persephonis 15 Gazi
Comme son nom l'indique, taverne de poissons de bonne tenue dont les prix varient selon le produit de la mer que vous choisissez. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, selon l'arrivage du jour (poissons frais, mais aussi salés ou fumés). Pour les viandards, alternative carnée avec Butcher Shop à côté, appartenant au même proprio.
Kanella, Konstantinoupoléos 70 Gazi
Resto découvert par hasard en arpentant le quartier. Rien à voir avec une taverne, il s'agit d'un lieu lumineux à la déco tout à la fois simple mais tendance. La carte est imaginative et propose des assiettes plus originales que la sempiternelle horiatiki et autres tiropites ; très bons plats de pâtes, viandes sautées relevées, salades sympas, saveurs méditerranéennes bien marquées en bouche, c'est vif et bien troussé. Service jeune et souriant.

























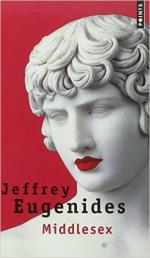















/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)