Le Voyeur (Peeping Tom)... une leçon de cinéma
Michael Powell - 1960
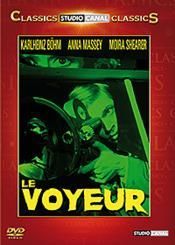
Là, indubitablement, on entre dans la légende, dans le singulier et l’inégalé, avec un film tellement audacieux et inconvenant qu’il brisa la carrière de son réalisateur. Sorti à quelques mois d’intervalle de Psychose, Le Voyeur (qui tourne lui-aussi autour de la figure d’un meurtrier psychopathe) fût crucifié par une critique anglaise déchaînée, à grand renfort de superlatifs cinglants et assassins. Une telle mise à l’Index trahit de façon sous-jacente l’uppercut reçu par le public de l’époque, dépourvu de défenses devant le corps à corps très inconfortable qui lui était imposé sur l’écran ; devenir lui-même voyeur, témoin privilégié, donc complice de meurtres, directement à travers l’objectif d’un assassin qui filme ses crimes.
Karlheinz Böhm (oui, oui, le Frantz de Sissi) prête ses traits poupins, ses mèches blondes et son regard bleu tendre à un jeune chef-opérateur solitaire et timide (Mark Lewis), obsessionnel des images, qui trimbale sur les plateaux de tournage comme dans la vie une caméra, pour filmer son quotidien, et ses meurtres sur pellicules. Son regard n’existe qu’au travers de son objectif, véritable prolongement physique de lui-même. Gangréné de névroses*, photographe de prostituées de bas-étages à ses heures, il voue une fascination perverse et dévorante aux visages de femmes à l’agonie, ravagés par la peur et voyant dans un miroir leur propre mort s’avancer.
On pourrait gloser et tartiner ad libitum sur le film tant les pistes d’analyse sont nombreuses :
- critique sociétale d’une Angleterre faussement puritaine et hypocrite, qui se vautre avec tartuferie dans la débauche la plus sordide
- élaboration d’une psychose et étude de la folie comme renversement d’un trauma originel
- confusion délibérée entre le sujet du film et la manière de filmer les actions du personnage (la forme appliquée au fond) – la corruption par l’image
- phénomènes de réverbération et de miroirs sans fin entre la caméra de Powell et celle de son héros qui se filment réciproquement. Où se place alors le spectateur ?
Au-delà des interrogations soulevées évidentes sur l’acte de filmer (qui revient ici à tuer), les responsabilités d’un réalisateur, la représentation de la violence à l’écran et la perversité du public, le film en lui-même, la mise en scène, la musique et les choix signifiants de Powell font du Voyeur une œuvre dense. Ce dernier s’amuse beaucoup à renverser les conventions du film d’angoisse pour souligner combien les images peuvent berner. Le héros a toute l’apparence d’un bon garçon en duffle-coat, doux et timide, buveur de lait, sans signe extérieur de déséquilibre, à l’opposé d’un Norman Bates. Il fait aussi de la lumière, habituellement familière et sécurisante un vecteur de terreur et d’angoisse. Le miroir, où se reflète le visage des victimes est déformant. Le monde des tournages, auquel participe Mark de part son métier, est dépeint avec ironie, ses membres ridiculisés, ses stars brocardées. Mark Lewis, l’homme qui VOIT, sera démasqué par une aveugle, sa voisine du dessous, qui passe ses nuits à épier ses déplacements suspects. Sa caméra ne vole pas seulement des images, elle est une arme redoutable dotée d’une lame tranchante. L’utilisation des lumières crues et des couleurs acides est volontairement caricaturale (oui, le cinéma n’est qu’artifice). La musique au piano qui accompagne les meurtres ressemble à celle des films muets et boucle ainsi - provisoirement en 1960 - , l’histoire du 7ème art.
Le Voyeur est réellement un film à part, téméraire et impertinent, où chaque image, chaque plan sont chargés de sens. Adoptant le point de vue d’un assassin, au propre comme au figuré, très critique vis-à-vis du cinéma (violeur d'intimité), pataugeant avec une délectation palpable dans les différentes expressions de la perversion, jubilant de mettre le spectateur mal à l’aise et de lui renvoyer ses propres vices, Michael Powell signe ici un manifeste monstrueux et fascinant.
* On peut regretter que Powell ait donné une source familiale aux névroses de Mark, un peu convenue et lourdement soulignée : si elle permet des scènes angoissantes et des règlements de comptes acides avec la cellule étouffante et corruptrice qu’est la famille, le fatras psy, la tension sexuelle sous-jacente convenue dès que Sigmund est appelé en renfort et ce souci de donner une racine à sa pathologie affaiblissent un peu la portée amorale du film. Si Powell ne juge jamais son héros, il le « victimise » trop facilement. Mais le scandale eut été sans doute trop dévastateur si Powell avait joué la provocation jusqu’au bout avec une folie sans cause… l’homme n’est pas encore condamné à sa liberté en 1960 outre-Manche…





 Oh, la claque ! Je suis à la fois atterrée d’être passée loin de ce film durant tant d’années et béate de joie qu’il ait enfin croisé mon chemin… mais aussi vermillon cramoisi devant mes lacunes cinématographiques. Á la décharge du public européen, ce film anglais fut un échec lors de sa sortie, boycotté par ses producteurs et le distributeur, tombé aux oubliettes, mais devenu culte outre-Atlantique. « Indéniablement le plus beau film en Technicolor. Une vision jamais égalée » pour Martin Scorcese, « The Reds Shoes est le seul film à voir avant de mourir », pour Francis Ford Coppola.
Oh, la claque ! Je suis à la fois atterrée d’être passée loin de ce film durant tant d’années et béate de joie qu’il ait enfin croisé mon chemin… mais aussi vermillon cramoisi devant mes lacunes cinématographiques. Á la décharge du public européen, ce film anglais fut un échec lors de sa sortie, boycotté par ses producteurs et le distributeur, tombé aux oubliettes, mais devenu culte outre-Atlantique. « Indéniablement le plus beau film en Technicolor. Une vision jamais égalée » pour Martin Scorcese, « The Reds Shoes est le seul film à voir avant de mourir », pour Francis Ford Coppola.
 Homère, Iliade - relecture d’Alessandro Baricco – Éditions Albin Michel, 2006
Homère, Iliade - relecture d’Alessandro Baricco – Éditions Albin Michel, 2006




































/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)