Trois mois de la vie d'une femme
 La Femme du métro (Η κυρία Κούλα - 1978), court roman de Ménis Koumandaréas*
La Femme du métro (Η κυρία Κούλα - 1978), court roman de Ménis Koumandaréas*
Traduction Michel Volkovitch
Quidam éditeur, 2010
J’aurais tant aimé partager l’enthousiasme général, m’inscrire dans le cercle des amoureux de madame Koula, être touchée par cette histoire toute simple qui a visiblement ému tant de lecteurs et de critiques ; peine perdue, je reste obstinément à la porte. J’ai beau lire et relire ces cinquante-quatre pages, la magie n’opère pas, je baille totalement détachée, insensible à cette brève rencontre entre une quadra (Koula) et un étudiant (Mimis), dans la capitale grecque fraîchement débarrassée de ses colonels.
Chaque soir, à huit heures, les deux protagonistes se croisent dans le même métro (à cette époque, seule la ligne « verte » existe), s’apprivoisent, se séduisent, partagent une éphémère liaison et s’éloignent définitivement. Résumé ainsi, on pourrait craindre un excès de sentimentalisme ou de romanesque dégoulinant, c’est tout l’opposé. Que c’est sec, raide, cruel ! Parce que Ménis Koumandaréas ne fait pas grand cas de ses deux personnages. Sans être franchement antipathiques, ils ne sont juste que l’incarnation de deux générations, de deux parcours, de deux modes de vie qui vont se télescoper à l’heure où le pays se libère de ses chaînes, dans un bouillonnement politique intense. Il ne s’agit pas d’une vraie histoire d’amour décortiquée, analysée (amateurs de Stefan Zweig, passez votre chemin), juste d’un prétexte pour une impossible rencontre entre deux réalités sociales.
Ainsi, les personnages sont stéréotypés, comme deux monolithes dotés d’habitus trop bien définis. L’auteur s’attarde sur des descriptions de vêtements qui enferment (manteau sévère, tailleur strict et lingerie compliquée de Koula) ou libèrent les individus (pantalon large et simple pull pour Mimis), sur les lieux que fréquentent les bourgeois (les salons de thé où l’on s’ennuie) et les individus libres (les rades crasseux populaires), sur les choix des professions, des lieux d’habitation… tout est binaire, en opposition, sans connexion, sans harmonie. On pourrait pu s’attendre au moins à une sensualité fougueuse, une passion physique dévorante qui permettrait de tendre un pont entre ces deux êtres que tout oppose, mais non, Ménis Koumandaréas bride la moindre velléité de débordement. On se rencontre dans le métro, on prend un verre dans une cave, on échange ses fluides corporels dans une chambre en sous-sol : ce qu’on étouffe dans ce roman !
Mimis est un gamin vaniteux, égoïste, sexuellement attiré par les femmes en âge d’être sa mère, qui s’accommode très bien aussi des relations tarifées, et qui excelle en commentaires acerbes, réquisitoires, condamnations du mode de vie « nantie » de ses conquêtes. L’auteur n’accorde même pas aux deux amants une période heureuse de complicité : Koula et Mimis ne sont pas sur la même longueur d’ondes, même dans leur garçonnière. L’étudiant se lassera très vite d’une femme qui sent vaciller ses certitudes et qui a peur de goûter la liberté une fois la porte de sa cage ouverte ; Koula ne supportera pas longtemps la remise en question permanente de sa vie bien rangée.
Si je n’adhère absolument pas à l’histoire qui nous est racontée, il faudrait être sourde pour ne pas entendre la langue de Koumandaréas, sa rythmique, sa musicalité. Le texte file vite, les phrases sont courtes, dégraissées, les descriptions, frugales. L’auteur alterne une cadence rapide pour Mimis et des monologues au ralenti pour les atermoiements de Koula : un monde nouveau s’ouvre pour l’étudiant, celui de la mère de famille, déjà écrit, s’étire avec monotonie.
La Femme du métro est un roman daté qui manque de nuances, de subtilités. Certains lecteurs y voient une « ode à la jeunesse et à la beauté qui passent à toute allure, une hantise du vieillissement, une échappée mélancolique douce-amère, le rappel que le bonheur ne saurait durer…». Nous n’avons visiblement pas la même lecture de l’ouvrage.
* Romancier et essayiste athénien (1931-2014)






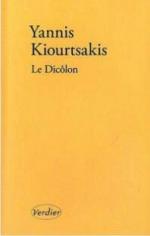














































/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F38%2F875519%2F110987439_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F60%2F875519%2F108616715_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F31%2F875519%2F106569816_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F73%2F88%2F875519%2F106565152_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F27%2F875519%2F104369771_o.jpg)